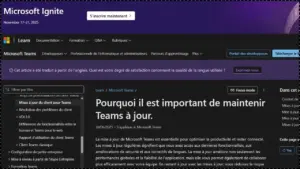Haïti s’est récemment engagé dans un investissement de 13,5 millions de dollars pour développer l’énergie solaire, parallèlement à la poursuite d’un programme de coopération avec le Fonds monétaire international (FMI). Ce double mouvement, entre développement durable et appui macroéconomique, vise à redresser une économie en crise chronique. Mais ces efforts suffiront-ils à sortir le pays de la récession, à restaurer la confiance des investisseurs et à amorcer une transition vers la stabilité ?

L’investissement de 13,5 millions de dollars dans le solaire et la coopération renforcée avec le FMI symbolisent la volonté d’Haïti de reprendre en main son destin économique. Ces initiatives conjuguent innovation, discipline budgétaire et transition écologique — trois leviers indispensables à la reconstruction d’un État affaibli.
Le chemin reste long et semé d’embûches, mais il existe une perspective de redressement, à condition de maintenir le cap sur la sécurité, la transparence et la stabilité institutionnelle. Comme l’a résumé un économiste haïtien : Haïti n’a pas besoin d’un miracle, mais d’un plan et de la confiance pour le mener à bien.
Table of Contents
Un pays pris dans une crise structurelle
Depuis plus d’une décennie, Haïti fait face à une succession de chocs politiques, économiques et sociaux. La croissance reste négative depuis plusieurs années, tandis que la monnaie nationale, la gourde, a perdu une part considérable de sa valeur. L’inflation dépasse aujourd’hui les 30 %, rongeant le pouvoir d’achat et plongeant des millions de familles dans la pauvreté.
La situation est aggravée par l’insécurité généralisée. Les gangs contrôlent de larges portions du territoire, paralysant la circulation des biens et des personnes. L’administration publique, affaiblie par des années d’instabilité politique, peine à assurer les services de base. Dans ce contexte, les investissements privés se sont effondrés, et la production nationale ne couvre plus les besoins essentiels.
Le pays dépend largement des importations pour son alimentation, son énergie et ses produits manufacturés. Cette dépendance alimente les déséquilibres extérieurs et expose l’économie aux chocs de prix mondiaux. La facture énergétique, en particulier, reste une lourde charge : plus de 80 % de l’électricité provient de générateurs diesel, alimentés par des importations coûteuses et polluantes.
Le rôle du FMI : un filet de sécurité fragile
Face à cet effondrement, Haïti s’est tourné vers le Fonds monétaire international dans le cadre d’un programme de suivi économique, connu sous le nom de Staff-Monitored Program (SMP). Ce mécanisme, bien que non assorti d’un financement direct, permet au pays de démontrer sa capacité à respecter certaines règles macroéconomiques en vue d’un futur appui financier plus substantiel.
Le FMI salue les progrès récents dans la stabilisation budgétaire et le maintien des réserves internationales, qui couvrent environ sept mois d’importations. Les transferts de la diaspora — pilier essentiel de l’économie haïtienne — ont continué d’alimenter ces réserves, apportant un peu d’oxygène à la balance des paiements.
Cependant, l’institution souligne la fragilité de ces avancées. La croissance reste faible, la base fiscale demeure étroite et la gouvernance économique, minée par la corruption et la faiblesse institutionnelle, entrave les réformes. Le FMI recommande un renforcement de la transparence budgétaire, une meilleure gestion des subventions énergétiques et un recentrage des dépenses publiques sur les secteurs productifs.
En parallèle, l’organisme insiste sur la nécessité d’améliorer la sécurité intérieure, condition indispensable au retour des investisseurs et au fonctionnement normal de l’économie. Sans cela, les efforts macroéconomiques risquent de rester théoriques.
L’investissement solaire de 13,5 millions de dollars : un pari énergétique et social
Objectif et nature du projet
L’investissement de 13,5 millions de dollars dans le secteur solaire marque une étape importante pour Haïti. Porté par un partenariat entre des institutions financières internationales et le secteur privé, le projet soutient la société haïtienne Solengy Haiti S.A., spécialisée dans la production et la distribution d’énergie solaire.
Le financement prévoit la mise en place d’environ 10 mégawatts-crête de capacité photovoltaïque et 20 mégawattheures de stockage. L’objectif est d’alimenter des zones rurales et périurbaines peu desservies par le réseau électrique national. L’électricité ainsi produite doit permettre d’alimenter des ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises locales, tout en réduisant la dépendance au diesel.
Ce modèle repose sur un système “solar-as-a-service” : les utilisateurs n’ont pas besoin d’investir dans les installations, mais paient un tarif mensuel pour accéder à l’énergie. Cette approche vise à rendre le solaire accessible à un plus grand nombre de foyers et d’entreprises, malgré la faiblesse du pouvoir d’achat.
Un levier pour la résilience économique
Cet investissement dans le solaire répond à plusieurs urgences simultanées. D’abord, il s’attaque à l’un des principaux goulets d’étranglement de l’économie haïtienne : l’accès à une énergie fiable et abordable. Dans de nombreuses régions, les coupures de courant sont quotidiennes, et les coûts de l’électricité peuvent être jusqu’à trois fois supérieurs à ceux de la moyenne régionale.
En réduisant la facture énergétique, le solaire peut libérer des ressources pour d’autres usages productifs et améliorer la compétitivité des petites entreprises. Il pourrait également soutenir les services publics essentiels. Des hôpitaux mieux alimentés en électricité signifient des soins plus sûrs ; des écoles équipées peuvent fonctionner plus longtemps ; des administrations locales peuvent continuer à rendre des services même en période de crise.
Sur le plan environnemental, le développement de l’énergie solaire participe aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre la déforestation, aggravée depuis des décennies par la dépendance au charbon de bois.
Un signal positif pour les investisseurs
Au-delà de ses effets directs, cet investissement envoie un message symbolique : Haïti reste un terrain d’action possible pour les investisseurs internationaux, malgré les défis sécuritaires et institutionnels. Il démontre qu’un projet structuré, axé sur la durabilité et appuyé par des partenaires crédibles, peut mobiliser des capitaux étrangers.
Cela pourrait, à terme, encourager d’autres initiatives dans les domaines des infrastructures, de l’agro-industrie ou des technologies propres. Le succès du solaire constituerait un précédent pour bâtir un écosystème économique plus diversifié et moins dépendant de l’aide humanitaire.
Des défis considérables persistent
Malgré son potentiel, ce plan énergétique ne saurait être une panacée. Haïti doit affronter plusieurs obstacles majeurs avant de transformer cette initiative en moteur de développement durable.
Sécurité et logistique
Les zones d’intervention ciblées par le projet solaire se situent parfois dans des territoires contrôlés par des groupes armés. La construction et la maintenance des installations peuvent y être interrompues ou rendues dangereuses. Le transport des équipements à travers des routes mal entretenues ou bloquées complique encore la mise en œuvre.
Gouvernance et institutions
Le cadre réglementaire du secteur de l’énergie reste fragile. L’État haïtien manque de moyens pour contrôler les concessions, garantir la transparence des contrats ou assurer la pérennité des politiques publiques. L’absence d’une stratégie énergétique nationale cohérente freine la coordination entre les acteurs publics et privés.
Viabilité économique
La faible solvabilité de nombreux ménages pourrait limiter la rentabilité du modèle “solar-as-a-service”. Si les subventions ou les partenariats communautaires ne sont pas bien calibrés, une partie de la population pourrait rester exclue des bénéfices du programme. De plus, la dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux soulève la question de la durabilité financière à long terme.
Un pari sur la transition verte et la stabilité
L’initiative solaire s’inscrit dans une tendance mondiale visant à promouvoir des infrastructures résilientes dans les pays fragiles. En combinant durabilité, inclusion et innovation financière, elle incarne une approche nouvelle du développement dans les contextes de crise.
Pour Haïti, cette stratégie pourrait marquer le début d’une transition énergétique verte, porteuse d’emplois et de stabilité. Elle s’aligne également sur les engagements climatiques internationaux, offrant au pays une chance de participer aux mécanismes de financement climatique.
Mais cette réussite dépendra de la capacité du gouvernement à instaurer un environnement de confiance. Une gouvernance claire, la lutte contre la corruption et la sécurisation des sites seront des conditions essentielles. L’implication des communautés locales, souvent marginalisées, sera également déterminante pour assurer l’appropriation du projet.
Le rôle du FMI : ancrer la discipline budgétaire
En parallèle, le programme du FMI peut jouer un rôle de catalyseur. En soutenant la discipline budgétaire et en encadrant les réformes économiques, il contribue à créer un cadre plus stable pour les investissements privés.
L’objectif à moyen terme est de restaurer la crédibilité financière de l’État haïtien. Cela passe par la modernisation de l’administration fiscale, la rationalisation des dépenses et une meilleure traçabilité des fonds publics. Le FMI encourage aussi la digitalisation des paiements publics et la promotion de la transparence dans les marchés publics.
Si ces mesures s’appliquent efficacement, elles pourraient renforcer la confiance des bailleurs et permettre à Haïti d’accéder à des financements concessionnels, indispensables pour soutenir les infrastructures et la transition énergétique.
Une opportunité fragile mais réelle
Le double appui du FMI et de l’investissement solaire ne transformera pas Haïti du jour au lendemain. Cependant, il ouvre une fenêtre d’opportunité rare dans un pays longtemps abandonné aux urgences humanitaires. Pour la première fois depuis des années, le débat national s’oriente vers des solutions structurelles : énergie, productivité, gouvernance.
Le défi consiste désormais à faire converger ces initiatives dans une vision cohérente de développement. Si le solaire réussit, il pourrait servir de catalyseur pour d’autres réformes : diversification de l’économie, soutien à l’agriculture durable, et amélioration des infrastructures publiques.
Mais l’équilibre reste fragile. Une recrudescence de la violence, une chute des transferts de la diaspora ou un blocage politique pourraient rapidement anéantir les progrès réalisés. La stabilité politique, plus que toute autre variable, sera le véritable juge du succès de ces programmes.