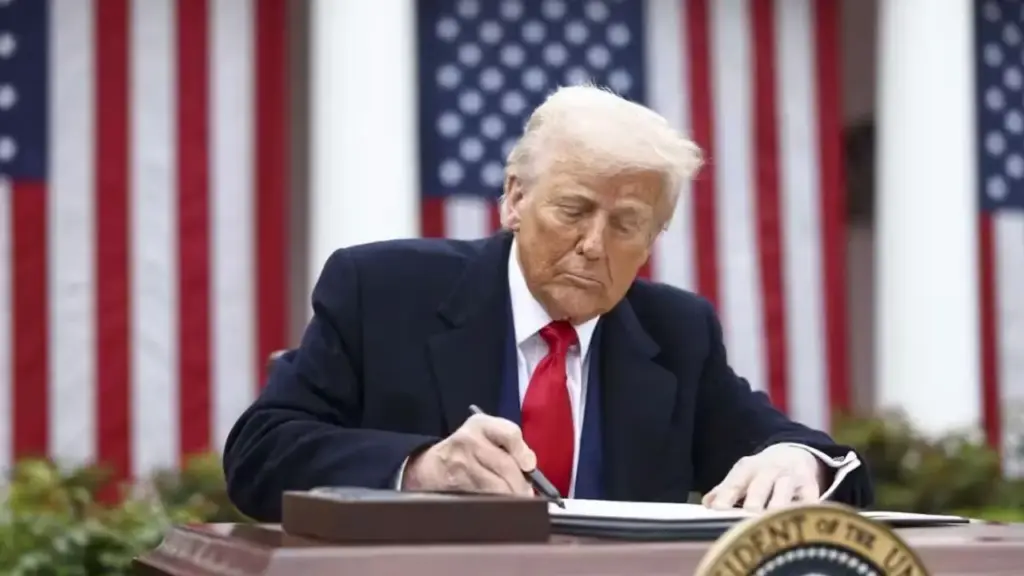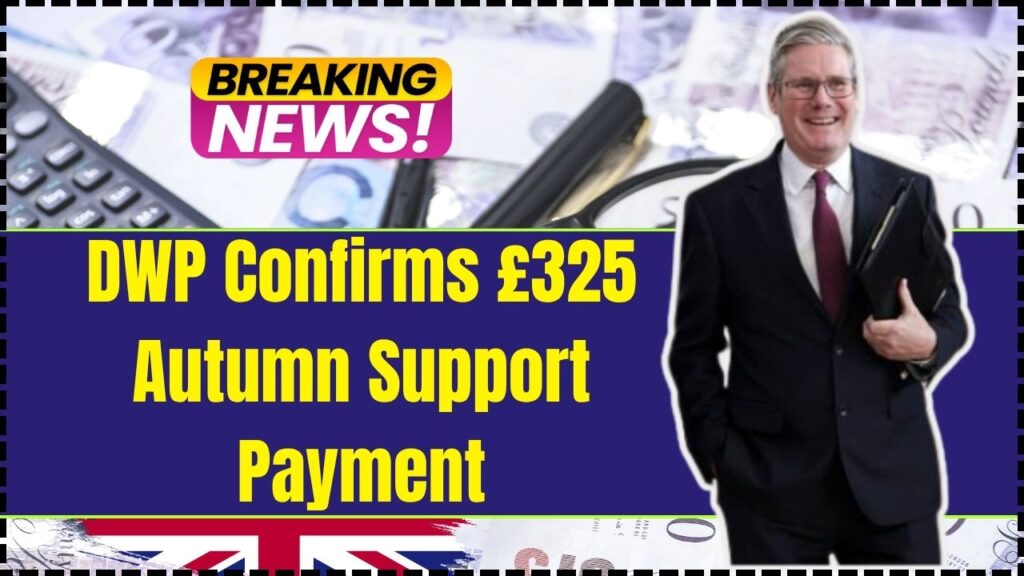Le débat sur la Zucman, souvent surnommée « taxe Zucman », agite à nouveau la scène politique française. Inspirée par les travaux de l’économiste Gabriel Zucman, cette proposition vise à instaurer un impôt minimal de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros. Défendue comme une mesure de justice fiscale et d’efficacité budgétaire, elle est perçue par certains de ses opposants comme un « cadeau fiscal caché » offert aux plus grandes fortunes. Entre considérations économiques, enjeux constitutionnels et dimension internationale, cette initiative cristallise les tensions au moment où s’élabore le budget 2026.

Le rejet de la taxe Zucman par le Sénat en juin 2025 n’a pas clos le débat. Au contraire, il l’a relancé dans la perspective du budget 2026. Les partisans de la justice fiscale y voient une occasion historique de rééquilibrer le système, tandis que ses opposants redoutent une mesure inefficace, voire contre-productive.
L’avenir de la taxe dépendra désormais de la capacité du gouvernement à bâtir un compromis entre ambition sociale et pragmatisme économique. Comme le résume un parlementaire : « Le vrai défi est de faire en sorte que la justice fiscale ne se transforme pas en illusion fiscale.
La genèse de la taxe Zucman
Une réponse à l’érosion de l’impôt
Depuis plus d’une décennie, les études de Gabriel Zucman, professeur à l’Université de Berkeley, documentent l’ampleur de l’optimisation fiscale pratiquée par les multinationales et les ménages très fortunés. Ses recherches, menées avec des collègues comme Emmanuel Saez, montrent que les ultra-riches parviennent souvent à réduire leur taux effectif d’imposition bien en dessous de celui des classes moyennes.
En 2023, Zucman a été mandaté par le G20 pour rédiger un rapport sur la fiscalité des très grandes fortunes. Ce rapport, rendu public en 2024, propose d’instaurer un impôt plancher mondial pour les ménages disposant d’un patrimoine supérieur à 100 millions de dollars ou d’euros. L’objectif : s’assurer que nul milliardaire ne puisse payer proportionnellement moins d’impôts qu’un citoyen ordinaire.
Une idée transposée en France
L’idée a trouvé un écho particulier en France, pays marqué par un débat récurrent sur l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), supprimé en 2018 et remplacé par l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI). La suppression de l’ISF avait été présentée comme un levier pour favoriser l’investissement, mais elle a également nourri un sentiment d’injustice fiscale.
C’est dans ce contexte que la proposition dite « taxe Zucman » a été déposée à l’Assemblée nationale début 2025. Le texte prévoyait l’instauration d’un impôt minimal de 2 % du patrimoine net pour les foyers dépassant le seuil des 100 millions d’euros. Le mécanisme devait fonctionner comme un complément d’impôt : si l’ensemble des taxes et impôts payés par un foyer n’atteignait pas ce plancher, il devait acquitter la différence.
Ce que prévoit concrètement la mesure
Les modalités techniques
Le projet, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, définit plusieurs éléments clés :
- Un seuil élevé : seuls les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros sont concernés, ce qui représente environ 1 800 ménages en France.
- Un taux de 2 % : appliqué sur la valeur nette du patrimoine, calculé après déduction des dettes.
- Une assiette large : incluant les actifs financiers, les participations dans des sociétés, les biens immobiliers et les actifs professionnels.
- Un mécanisme correctif : le montant dû s’ajoute seulement si l’ensemble des impôts payés reste inférieur à 2 % du patrimoine.
Les recettes espérées
Selon les estimations du Conseil d’analyse économique et des équipes de Zucman, la taxe pourrait générer entre 10 et 25 milliards d’euros par an pour les finances publiques. Ces sommes permettraient de financer des investissements publics ou de réduire le déficit budgétaire. Pour certains économistes, il s’agit d’un levier décisif pour restaurer la progressivité fiscale et la confiance dans l’État.
Les arguments en faveur de la taxe
Une mesure de justice fiscale
Les partisans de la taxe insistent sur son rôle correctif. Selon eux, il est difficilement justifiable que des ménages possédant plusieurs centaines de millions d’euros contribuent proportionnellement moins au financement public qu’un salarié de la classe moyenne.
Il va être très difficile de demander aux Français de faire des efforts tant que les milliardaires paieront si peu d’impôts , rappelait récemment Gabriel Zucman dans un entretien. Pour ses soutiens, la taxe Zucman n’est pas un instrument idéologique mais une exigence de justice et de cohérence.
Une ressource budgétaire cruciale
Dans un contexte marqué par la nécessité de financer la transition écologique, de renforcer les services publics et de réduire la dette, la mesure est perçue comme une source de recettes importantes. Contrairement à des hausses généralisées de la TVA ou de l’impôt sur le revenu, elle cible un groupe restreint mais extrêmement fortuné.
Une portée internationale
Enfin, la taxe s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la coordination fiscale mondiale. De la même manière que l’impôt minimum de 15 % sur les bénéfices des multinationales a été adopté par l’OCDE, les partisans espèrent qu’une taxe Zucman pourrait devenir un standard international. La France pourrait alors jouer un rôle de pionnier en lançant le mouvement.
Les critiques et risques soulevés
L’exil fiscal redouté
Les opposants alertent sur un risque majeur : l’exil fiscal. Selon eux, certains milliardaires pourraient déplacer leurs fortunes ou leur résidence fiscale vers des pays plus cléments, ce qui réduirait l’assiette et rendrait la taxe inefficace. Les exemples passés de départs de fortunes françaises, notamment après l’instauration de l’ISF, sont régulièrement cités dans ce contexte.
Les effets sur l’investissement
Un autre argument avancé est le risque de freiner l’investissement. En taxant aussi les actifs professionnels et les participations dans des entreprises, la mesure pourrait décourager la prise de risque ou l’entrepreneuriat familial. Certains économistes et représentants du patronat estiment que la taxe pourrait fragiliser l’attractivité de la France pour les investisseurs internationaux.
La complexité technique
La mise en œuvre pose également des défis techniques considérables. Comment valoriser les actifs non cotés ? Comment évaluer les holdings, souvent complexes et internationales ? Comment éviter la double imposition ou les transferts artificiels d’actifs vers des juridictions moins taxées ?
Les critiques politiques
Enfin, des voix au Sénat ont dénoncé un texte « mal calibré » et potentiellement contraire aux principes constitutionnels. Le 12 juin 2025, la chambre haute a rejeté la proposition, estimant qu’elle posait des risques juridiques et économiques trop importants.
La dimension politique
Une fracture gauche-droite
La taxe Zucman illustre la polarisation politique en France. À gauche, elle est portée comme un symbole fort de justice sociale et de redistribution. Plusieurs députés de la Nupes ont défendu une version encore plus ambitieuse, sans concessions sur l’assiette.
À droite et au centre, les critiques dominent. Pour de nombreux sénateurs, le texte relève davantage du symbole politique que d’un outil efficace. Ils défendent des solutions alternatives, comme une meilleure lutte contre l’évasion fiscale ou une taxation ciblée sur certains types d’actifs.
Un gouvernement sous pression
Le gouvernement, qui doit présenter le budget 2026, se trouve face à un dilemme : répondre à la demande de justice fiscale d’une partie de l’opinion publique tout en rassurant les milieux économiques et financiers. Selon plusieurs sources parlementaires, des arbitrages sont encore en cours pour déterminer si une version amendée de la taxe pourrait être intégrée dans la loi de finances.
Cadeau fiscal caché » ou mesure corrective ?
L’expression « cadeau fiscal caché » a émergé dans le débat lorsque certains opposants ont souligné que le seuil de 100 millions d’euros excluait en réalité la majorité des foyers aisés, concentrant l’effort sur un nombre très réduit de contribuables. Pour ces critiques, le dispositif risque d’apparaître plus symbolique que réellement efficace, en exonérant indirectement des fortunes « intermédiaires » de toute contribution supplémentaire.
D’autres dénoncent le risque d’un « effet d’aubaine » : certains foyers, dont la contribution actuelle dépasserait déjà le plancher, ne seraient pas concernés, ce qui donnerait l’impression d’une taxation limitée.
Les partisans répondent que la mesure vise précisément les ménages les plus fortunés et qu’elle ne peut pas être jugée comme un allégement déguisé. Au contraire, ils soulignent que sans un mécanisme contraignant, les milliardaires continueront à profiter d’optimisations agressives, laissant peser l’effort sur le reste de la population.
Naviguer dans le Processus d’Enregistrement et de Facilitation des Entreprises en Haïti
Une perspective internationale
La France n’est pas isolée dans ce débat. Aux États-Unis, des figures politiques comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders militent depuis plusieurs années pour un wealth tax. En Allemagne, certains partis plaident pour une taxe sur la fortune, tandis que dans d’autres pays européens, les discussions restent limitées.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) observe attentivement ces initiatives, dans la continuité de son projet sur l’imposition minimale des multinationales. Si un accord multilatéral sur la taxe Zucman semble encore lointain, la France pourrait jouer un rôle d’avant-garde.