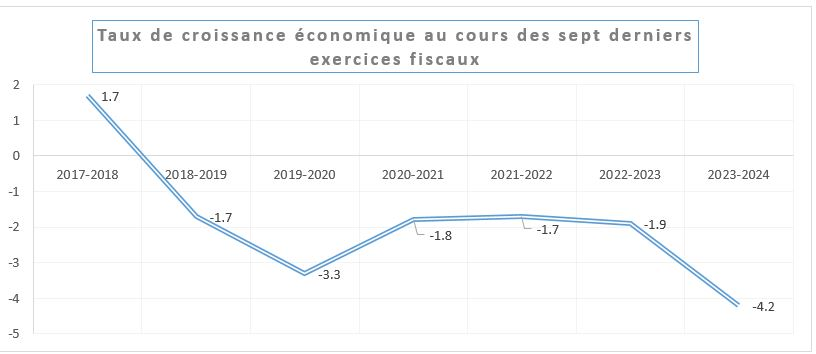Les investissements directs étrangers (IDE) en Haïti ont franchi en 2024 un cap inédit, selon un rapport récent de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Cette progression surprend les analystes, dans un pays souvent associé à l’instabilité politique, à l’insécurité et à la fragilité institutionnelle. Pour la première fois depuis plus d’une décennie, Haïti se positionne comme une destination qui attire des capitaux significatifs, notamment dans l’énergie, le textile et les infrastructures.

La hausse record des investissements directs étrangers en Haïti illustre la complexité d’une économie fragile mais dotée d’un fort potentiel. Entre opportunités industrielles, appuis multilatéraux et volonté d’anticiper un redressement, les capitaux étrangers ouvrent une nouvelle phase. Mais la persistance de l’instabilité politique et des défis sécuritaires empêche toute certitude sur la pérennité de cette tendance.
Pour l’heure, Haïti incarne à la fois un risque majeur et une promesse inexploitée dans la Caraïbe. Les mois à venir, marqués par la perspective d’élections et de réformes, seront décisifs pour déterminer si ce regain d’intérêt s’inscrit dans la durée ou s’il ne constitue qu’un épisode passager.
Un record inattendu dans un contexte fragile
Selon la CNUCED, les flux d’IDE vers Haïti ont dépassé les 400 millions de dollars en 2024, soit une hausse estimée à plus de 30 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre représente le plus haut niveau enregistré depuis 2010, année du séisme dévastateur qui avait paralysé une grande partie de l’économie nationale.
Pour de nombreux observateurs, ce regain d’intérêt est paradoxal. Haïti figure encore parmi les pays les plus pauvres de l’hémisphère occidental, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant inférieur à 2 000 dollars selon la Banque mondiale. Pourtant, les flux d’investissements étrangers progressent alors même que la situation sécuritaire reste préoccupante, avec la multiplication des violences urbaines et la fragilité du système politique.
Les moteurs de l’afflux de capitaux
Le rôle du secteur textile
Historiquement, le secteur textile constitue l’un des principaux pôles d’attraction des IDE en Haïti. Grâce aux accords commerciaux HOPE et HELP signés avec les États-Unis, les entreprises opérant dans le pays bénéficient d’un accès préférentiel au marché américain. Cette situation a encouragé l’installation d’usines d’assemblage, particulièrement dans la zone franche de Caracol, dans le nord du pays.
En 2024, de nouveaux contrats ont été signés avec des groupes américains et coréens spécialisés dans la confection. Selon le ministère haïtien de l’Économie et des Finances, ces accords devraient générer plus de 15 000 emplois supplémentaires dans les cinq prochaines années.
L’énergie renouvelable comme nouvel atout
L’autre moteur de l’investissement étranger réside dans l’énergie. Plusieurs projets de parcs solaires et éoliens ont été lancés, soutenus par des consortiums européens et américains. Ces initiatives visent à réduire la dépendance du pays aux importations de carburants, qui représentent une lourde charge pour les finances publiques.
D’après Luis Ortega, analyste en énergie pour l’ONG Global Energy Monitor, « les projets renouvelables en Haïti intéressent particulièrement les investisseurs car ils bénéficient d’un fort soutien multilatéral et répondent à un besoin critique : moins de 40 % de la population a accès à l’électricité de manière fiable. »
Infrastructures et logistique
Enfin, plusieurs entreprises chinoises et canadiennes ont investi dans la modernisation des ports de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Ces travaux visent à améliorer la logistique et à renforcer le rôle d’Haïti comme plateforme régionale pour le commerce caribéen.
Comparaison régionale : Haïti face à ses voisins
La progression des IDE en Haïti contraste avec celle de ses voisins immédiats. La République dominicaine, avec laquelle Haïti partage l’île d’Hispaniola, a attiré près de 4 milliards de dollars d’IDE en 2024, selon la Banque centrale dominicaine. Cette différence illustre l’écart de développement entre les deux pays, mais aussi le potentiel inexploité d’Haïti.
Comparée à d’autres économies caribéennes comme la Jamaïque ou Trinidad-et-Tobago, Haïti reste en retrait, mais le dynamisme actuel pourrait marquer un début de rattrapage. Pour Claudine Brossard, chercheuse au Centre d’études caribéennes de l’Université de Montréal, « si la tendance se confirme, Haïti pourrait réduire l’écart qui le sépare de ses voisins. Mais cela exige des réformes profondes et une amélioration tangible de la gouvernance. »
Les risques qui inquiètent les investisseurs
Instabilité politique chronique
Haïti traverse depuis plusieurs années une crise institutionnelle majeure. L’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a plongé le pays dans une incertitude durable. Depuis, les élections sont régulièrement reportées et la vacance du pouvoir présidentiel complique toute perspective de stabilité.
Cette situation fragilise les investisseurs étrangers, contraints de composer avec un climat réglementaire imprévisible. Plusieurs projets annoncés ces dernières années ont été retardés, faute d’un cadre légal clair ou de garanties suffisantes.
Insécurité et gangs armés
L’expansion des groupes armés dans la capitale et dans certaines régions clés constitue une autre menace. Les enlèvements, les blocages de routes et les violences urbaines pèsent lourdement sur l’environnement des affaires. Certaines entreprises étrangères ont dû renforcer leurs mesures de sécurité ou suspendre temporairement leurs activités.
Un rapport publié en 2024 par l’Organisation des Nations unies (ONU) estime que près de 80 % de Port-au-Prince est sous le contrôle direct ou indirect de gangs armés. Cette réalité accroît le coût des opérations et limite l’attrait de nouveaux projets.
Vulnérabilité environnementale
Enfin, Haïti reste l’un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Les ouragans, les inondations et les tremblements de terre représentent des risques permanents pour les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement. Pour les investisseurs, ces menaces exigent des assurances élevées et une anticipation des coûts supplémentaires.
Naviguer dans le Cadre Légal et Réglementaire Haïtien : Un Guide pour les Investisseurs
Le rôle des institutions internationales
L’intérêt accru pour Haïti ne peut être dissocié du rôle des institutions multilatérales. La Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque mondiale et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) soutiennent activement plusieurs projets structurants.
En 2024, la BID a approuvé un financement de 250 millions de dollars pour des infrastructures routières et électriques. Ce type de soutien agit comme un levier, rassurant les investisseurs privés et facilitant la mise en œuvre des projets.
De plus, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé un programme de coopération technique visant à renforcer la capacité institutionnelle du ministère haïtien de l’Économie. Cette initiative devrait améliorer la gestion des flux d’IDE et réduire les risques liés à la corruption.
Des perspectives contrastées
Les économistes soulignent que la tendance actuelle pourrait marquer un tournant, mais rien ne garantit sa durabilité. Les IDE en Haïti représentent encore une part marginale des flux dirigés vers l’Amérique latine et la Caraïbe. Sans réformes institutionnelles et amélioration sécuritaire, l’attrait du pays pourrait rapidement s’essouffler.
Pour André Joseph, consultant indépendant basé à Miami, « les investisseurs présents aujourd’hui jouent un pari à long terme. Ils savent que le potentiel d’Haïti est réel, mais ils avancent avec prudence, conscients que la moindre crise peut inverser la dynamique.